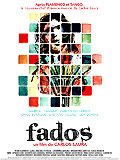FADOS
Do Ré Mi Fado

Le Fado se chante les yeux fermés, mais le film que Saura consacre à ce genre musical populaire lusitanien mérite que l’on garde les yeux grands ouverts. Immédiatement, la musique nous touche en plein cœur, à cet endroit où siège le goût esthétique de la mélodie. Le rythme, qui se donne instinctivement, n’a nul besoin d’un argumentaire détaillé ou d’une présentation constructive : quelques images suffisent pour ouvrir « Fados », qui filment les rues étroites et bigarrées du quartier d’Alfama à Lisbonne, tandis que des silhouettes hétéroclites passent, telles des ombres, devant l’écran, tandis que des accords de guitare amoureusement plaqués nous accueillent dans ce monde que nous ne connaissons pas encore, peuplé de figures qui nous sont inconnues.
L’œil regarde les images mais l’ouïe, déjà, s’est imposée sur la vue ; l’oreille devient l’organe de prédilection de ce cinéma-là ; car pour évoquer la musique, Saura prend soin d’utiliser l’image comme véhicule de celle-ci – ou plutôt comme écho, comme la répétition infinie par le mouvement de la gestuelle sonore. Le Fado se chante les yeux fermés et les bras ballants, comme si le corps, devenu indépendant, se détachait du visage et de la voix, comme s’il peinait sous le poids de ces chansons si lourdes à porter qu’elles obligent à clore les paupières.
Ce genre si populaire, né sur les docks de Lisbonne, ayant parcouru le Mozambique, l’Angola et le Brésil, transformé, depuis sa naissance au milieu du XIXe siècle, en genre musical majeur et multiple dans ses formes, le Fado, donc, tient à une sorte de minimalisme chaste, d’épuration esthétique : un chanteur, homme ou femme, et un ou deux guitaristes. Cette structure simple a subi une évolution, bien sûr, et le travail de Saura consiste aussi à nous transmettre cette mutation plurielle de la musique à travers une multitude de variations du Fado, depuis l’icône Amalia Rodriguez, devenue icône cinématographique, jusqu’aux interprétations modernes de Mariza.
Face à la caméra, le Fado retrouve l’essence de la gestuelle chorégraphique, autrefois rejetée par les diktats conservateurs de Salazar et de la puissante Église, ici réintégrée à la mélodie : les danses, qui sont avant tout des mouvements purs, partagées entre rapidité et lenteur, entre postures lascives et expressions de colère. La caméra les filme comme elle capterait les choses de la nature, c’est-à-dire avec admiration.
Les « fadistes » ont aussi, ceci de particulier qu’ils s’adressent à l’autre partie de notre cœur, celle qui sert de nid aux émotions. Leurs chansons parlent de nostalgie, de perte, d’amour inassouvi ; elles évoquent de longues et douloureuses lamentations, semblent extraites directement de l’âme ; des miettes de souffrance qui ne s’interdisent toutefois pas une certaine gaîté. Dans ce Fado, une même phrase est souvent prononcée deux fois : la première fois pour transmettre le message lyrique, la seconde pour entourer celui-ci d’une émotion sensible et palpable. A cette occasion, le visage mute, la voix se fait plus puissante, le corps tremble dans son entier ; visuellement, un gros plan ou un zoom léger le soulignent comme un instant de grâce. Saura ne se contente pas d’être le témoin de la musique, il s’en fait le messager ; et sait, encore une fois, après « Flamenco » et « Tango », se faire l’idéal interprète cinématographique d’une pensée musicale.
Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteur