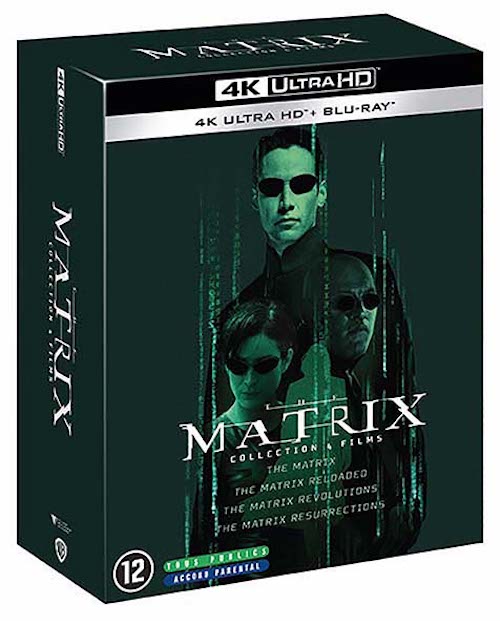MATRIX RESURRECTIONS
Pilule bleue
Dix-huit ans après avoir libéré l’humanité du joug des machines et sauvé la cité de Zion, Néo est redevenu programmeur de softwares à San Francisco et ne se souvient plus de rien. Les rêves qu’il fait et les pilules bleues que son psychiatre lui prescrit n’enlèvent rien à sa sensation que quelque chose cloche. Mais voilà que le « lapin blanc » revient sur son chemin et qu’un certain Morpheus apparaît devant lui pour lui proposer un choix crucial…

Avertissement : lire cette critique revient à prendre une pilule rouge et à accepter de se faire spoiler comme un cochon toutes les surprises et trucs inattendus que cette suite (pas du tout) attendue nous a minutieusement cachés avant sa sortie en salles. On vous laisse donc trois points de suspension pour faire votre choix… Merci d’avoir choisi. Parce qu’ainsi, vous aurez – sans le savoir – contribué à contredire la théorie complètement stupide au cœur de ce nouvel opus des aventures de Néo & Co. : « Le choix n’est qu’une illusion. Tu sais déjà ce que tu dois faire ». Pour une saga majeure de la SF contemporaine qui a contribué à encourager la démarche réflexive au détriment de la ligne claire impulsive (donc la prédominance du choix et du libre arbitre au-dessus de l’aliénation et du consensus mou), entendre une telle ânerie dès le premier quart d’heure fait déjà figure de mise en alerte. Celle-ci n’ira hélas que crescendo sur pas moins de 2h28 très vite apparentées à une longue et interminable séance de torture. Si l’on pensait que la trilogie "Matrix" s’était achevée sur une conclusion parfaite, où les points de suspension laissaient au spectateur le soin d’envisager lui-même l’écriture de la ligne du futur, le « Wake up » va en effet s’avérer hautement douloureux. Nous ne sommes plus dans les années 2000, mais dans une autre époque : celle du formatage à la Marvel et de l’exploitation outrancière du moindre truc à succès jusqu’à saturation. On ne s’attendait pas à ce que Warner Bros. – un studio de plus en plus à côté de la plaque ces derniers temps – fasse de même avec l’une des rares franchises qui avait su redorer son blason.
Le concept de "Matrix", qu’était-ce au fond ? Ni plus ni moins qu’une savante réappropriation de la littérature cyberpunk des années 80 (surtout William Gibson) et de tout un pan de la contre-culture geek (BD, manga, jeu vidéo, kung-fu, informatique, etc…) sous forme d’un spectacle visuellement inouï et thématiquement riche, conçu par deux têtes pensantes pour qui l’intelligence n’avait rien d’un gros mot. L’hydre à deux têtes s’étant réduite de moitié pour ce come-back tout sauf utile, il allait apparaître très important de voir comment les prolongations allaient pouvoir se jouer. D’autant que les jeux semblaient faits : Néo et Trinity envoyés ad patres, le programme Smith terrassé de l’intérieur au terme d’un duel-piège homérique, la cité de Zion sauvée de la destruction, l’humanité préservée par une paix avec les machines, un ciel radieux en fin de trilogie… what next ? Sans surprise, le titre du film grille toute surprise : des résurrections. Soit celle des deux héros décédés, reformatés en pions de la Matrice qui ont perdu leurs souvenirs d’antan. Ainsi donc, Trinity est devenue une mère de famille lambda qui répare des motos, et Néo est redevenu le programmeur Thomas Anderson. A ceci près que pour ce dernier, les choses ont changé : d’entrée, il nous est présenté comme le créateur d’un jeu vidéo nommé "Matrix", lequel a donné lieu à une trilogie cinématographique à laquelle les huiles de la Warner Bros. veulent d’urgence produire un quatrième film à gros budget… Oui, vous avez déjà deviné la grosse idée cachée derrière ce nouveau film…
Une mise en abyme de la trilogie "Matrix" en tant qu’objet artistique menacé par un Hollywood à fond dans la coolitude nerd, le formatage consensuel et la rentabilité à court terme : il n’en faut pas davantage pour déceler dans la stratégie de Lana Wachowski un missile théorique qui prendrait la Mecque du 7ème Art pour cible. Dans l’idée, le pari semble gagné dès le début, car tout est fait pour alimenter cet agacement de se sentir pris pour un con par Hollywood : les personnages ont troqué l’intelligence pour la lourdeur (mention spéciale à l’abruti de service qui se dit geek pour justifier sa gène avec les femmes !), les intentions du scénario sont répétées plusieurs fois de suite comme s’il fallait nous les faire passer au forceps, les pilules bleues – en réalité de simple tranquillisants – sont avalées en boucle par ce pauvre Keanu Reeves, et les paraboles philosophiques sont si surlignées au Stabilo qu’elles achèvent de transformer la porte ouverte en impasse – aucune réflexion possible ici. Tout ceci est bien sûr voulu : votre monde est la Matrice, on veut vous laver le cerveau, donc le film commence par incarner cet état d’esprit. Sauf que ce bug revendiqué continue de se propager lorsque le passage de la Matrice au monde réel s’opère. Monumentale erreur.
La logique d’un tel parti pris voudrait que le film torde non seulement la logique virale d’Hollywood tout en transcendant les principes visuels et narratifs de la trilogie d’origine. Lana Wachowski échoue hélas sur les deux tableaux. Question mise en abyme, elle n’arrive jamais à égaler le degré d’ironie et de ludisme dont pouvait faire preuve Wes Craven dans sa saga "Scream", la faute à un scénario qui ne théorise qu’en surface sa propre obsolescence de « séquelle » au lieu d’installer de petites bombes subversives dans chaque recoin de la narration. La conséquence la plus terrible de cet échec fait que l’on se retrouve face à un blockbuster basique, beaucoup trop bavard et peu généreux en action, qui passe tout son temps à exhiber plein cadre (et plein verbe !) les raisons qui justifient sa non-existence. Avec, en plus, une tendance au surlignage narratif qui contredit affreusement la force de la trilogie "Matrix". Prenons un exemple très concret. Sur le vertige et le confort que la Matrice provoque chez ceux et celles qu’elle asservit, il suffit de comparer une scène du premier "Matrix" avec une scène de "Matrix Resurrections". Dans l’un, une simple discussion entre Joe Pantoliano et Hugo Weaving autour d’un steak cuisiné dans un restaurant, et dans l’autre, une confrontation finale entre le couple vedette et le vilain central – un psychanalyste grotesque incarné par Neil Patrick Harris. Avant, deux dialogues et trois références cryptiques suffisaient à chuchoter une intention. Aujourd’hui, trois longs tunnels de dialogues expliquent tout, surlignent tout, déchiffrent tout, en laissant l’auto-réflexion et l’ouverture d’esprit crever au fond d’un disque dur rouillé. Toute la différence est là.
C’est là que "Matrix Resurrections" dévoile son vrai visage : le produit de son époque. Non plus celle des années 80-90 où l’exigence de fabrication se combinait avec une prise de risques en matière de concepts et une place active accordée à son public, mais celle de Marvel et de la postlogie "Star Wars", où le spectateur ne doit jamais faire le moindre effort intellectuel derrière son seau de pop-corn et avaler sans râler la sucrerie aseptisée qu’on lui donne à becter. Tout ce que le retour à la réalité va installer pour Néo et Trinity (et donc pour nous) n’est ainsi qu’un train fantômes de codes usités, répétés ad nauseam, jamais transcendés par le récit ou par la mise en scène, et sous-traités en palabres mollassonnes où deux ou trois bastons indignes d’une production Marvel font office de bouche-trou. Autre problème : dès son ouverture qui revisite en tous points (plans, dialogues, etc…) celle du premier film avec un témoin qui commente à notre place l’effet de « déjà vu », on sent venir le copier-coller faussement décalé qui va moins chercher à décaler l’effet originel de la trilogie qu’à le reproduire pour un public n’ayant visiblement pas la capacité de penser par lui-même. C’est le problème du Hollywood d’aujourd’hui : le spectateur doit avoir son petit papier lui expliquant ce qu’il doit comprendre, savoir ou penser. Et même quand on l’invite à quitter cette Matrice aliénante, la règle ne change pas : tout effet de rébellion est autant à proscrire que le moindre paramètre d’émancipation.
Les critères alors mis en place par Lana Wachowski pour tancer le système hollywoodien ressemblent à une série de doigts d’honneur dont la régularité achève de nous irriter. Précisons ainsi que le fameux bullet-time perd ici de son impact graphique pour devenir une utilité narrative totalement WTF, que la pilule rouge/bleue zappe son impact symbolique au profit d’une fonction plus répétitive et terre-à-terre, que les costumes d’antan ont laissé la place à un défilé de carnavals queer-punk du plus mauvais effet, que l’utilisation abusive d’extraits de la trilogie originelle multiplie les pistes pour nous faire anticiper les péripéties à venir (ce n’est plus du « déjà vu » mais du « déjà perçu »), que le climax final recrache tous les codes du zombie-movie pour ne jamais les retourner à des fins subversives, que ce cher Morpheus n’est plus un mentor charismatique mais un guignol de service qui s’imagine sur une scène de stand-up, et que ce pauvre Lambert Wilson lâche ici un adieu quasi-définitif à sa crédibilité d’acteur en réincarnant son Mérovingien de la plus triste des manières. Deux survivantes arrivent à s’extraire assez miraculeusement de ce naufrage : d’abord la bien trop rare Carrie-Anne Moss (ici dans un rôle sensiblement plus développé qu’avant), ensuite la très belle BO cosignée par le réalisateur Tom Tykwer (qui avait déjà fait des ravages avec les Wachowski sur "Cloud Atlas").
Que notre monde ait fini par devenir la Matrice tant prophétisée par les Wachowski n’est pas un scoop en soi pour ceux qui avaient encore la trilogie d’origine en tête. Mais qu’on se permette d’en rebooter la session subversivement codée pour mieux l’adapter aux standards du système qu’elle voudrait cibler et anéantir, là, non, ça ne passe pas ! L’échec est de toute façon si tangible dans chaque strate du récit qu’on doit avouer notre tentation d’avoir voulu fuir la salle de cinéma au bout d’une heure, histoire de mettre fin à ce doigt d’honneur sur format HD. En guise de bilan, on lance donc la traduction pour les informaticiens et les geeks : pour cause d’un update défaillant, le hacking savamment organisé en amont ne met pas bien longtemps à s’auto-fucker, ce qui fait qu’au final, le système entier reste intact, jamais menacé du moindre reboot et bétonné par une multitude de « modales » qui gardent le contrôle quoi qu’il advienne. Et ainsi, alors qu’on espérait un virus antisystème lâché dans la matrice hollywoodienne, on se retrouve hélas avec un blockbuster crypto-rebelle où plein d’agents Smith mal reformatés ont maladroitement oublié d’ôter leurs rictus et leurs lunettes de frimeur. Le comble du cynisme est atteint. Pilule bleue, svp.
Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur