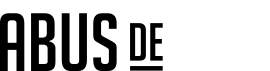MARIA
Justice pour Maria
Maria Schneider n’est encore qu’une adolescente lorsqu’elle se voit propulsée sur le devant de la scène avec un film devenu culte avec les années : « Dernier Tango à Paris ». En compagnie de Marlon Brando, elle découvre le métier d’actrice. Mais surtout elle découvre à quel point les feux de la rampe sont autant une bénédiction qu’une malédiction…

A force de nous lire, vous le savez maintenant : le genre du biopic n’est pas ce qui nous fait frétiller le plus, mais il n’est pas exempt de bonnes surprises, même si ces derniers temps on plutôt été fadasses de ce côté-là, avec les insipides "Back to Black" et "Bob Marley : One love". Force est de constater, qu’à la différence des exemples cités, "Maria" de Jessica Palud se range plus au niveau de ce que Sofia Coppola avait pu nous offrir avec "Priscilla" (2023) : un biopic engagé, qui donnait la parole à l’épouse du King, souvent étouffée et mise de côté par le prisme des médias en général, de l’époque mais aussi d’aujourd’hui. Une démarche sociale à l’heure où les femmes du monde (et en particulier celui du cinéma) ont commencé à parler et surtout à se faire entendre.
Et il est intéressant de constater que Jessica Palud et ses scénaristes se sont attachés (surtout sur la première partie du film) à raconter cette violence sourde et parfois brutale qui pouvait exister lors du tournage du film "Dernier Tango à Paris", réalisé par Bernardo Bertolucci en 1972. Maria Schneider dont c’est le premier grand rôle aux côtés d’une superstar désabusée et en fin de carrière (Marlon Brando, incarné ici par le génial mais trop rare aujourd’hui Matt Dillon) se voit propulsée autant en dehors de sa propre maison que sur le devant de la scène.
La justesse d’écriture est de mettre en avant cette héroïne qui finalement ne fait que payer l'environnement toxique créée par les hommes qui l’entourent (de façon consciente ou non). D’un côté nous avons son père, joué par Yvan Attal, acteur de seconds rôles qui aura passé sa carrière à courir après cette dernière en délaissant son mariage et sa famille. La conséquence c’est que Maria doit alors faire face à une mère rongée par la jalousie, le regret et la colère. A force que celle-ci soit un écho à son propre vécu, elle décide de la foutre à la porte littéralement. Considérée comme une « folle », elle n’est que la conséquence d’un homme qui l’a abandonnée et qui a fini par sombrer dans la rancœur et l’alcool.
Ce qui vient cristalliser ce propos c’est bien entendu la scène du "Dernier Tango à Paris" qui a fait scandale à l’époque pour son côté provocant et une séquence, disons-le, de viol autant fictionnel que réel. Oui, en se pensant tout puissants, cinéastes et acteurs, producteurs et scénaristes, les hommes qui régissent cette industrie se croient tout permis comme de ne pas prévenir l’actrice principale que la séquence qui va suivre va être toute autre. Tout ça bien entendu au nom de l’art et sous le prétexte de capter l’émotion la plus pure. Et on les connaît les anecdotes de tournages de cinéastes qui poussent leur casting dans leurs retranchements. Mais il s’agit ici d’autre chose : il s’agit littéralement d’une prise de pouvoir sur autrui et avec la complicité silencieuse de tout un plateau de tournage. Nous n’allons pas parler de la dite séquence plus longtemps tant elle est évidemment dérangeante, mais aussi parce que le film tente de poser des questions autour de la création qui sont assez pertinentes.
Mais la revanche fantôme de cette grande actrice broyée par un système qu’était Maria Schneider se fait aussi par l’actrice qui l'interprète ici. C’est la révélation du métrage, car via le regard d’une Anamaria Vartolomei habitée, on accompagne chacune de ses peines mais aussi de ses joies. On aurait aimé que la mise en scène soit tout aussi inspirée que son actrice principale. À la limite du documentaire, la forme stagne en arrivant sur une seconde partie plus convenue et plus narrative, là où les situations in medias res de la première moitié de métrage (directement au cœur de l’action) rendaient le tout rythmé et ludique à suivre. Nous ne remettons bien entendu pas en question l'honnêteté de la démarche et la qualité de la production (superbes jeux sur les couleurs des vêtements et des décors, casting impeccable et une bande sonore sublime composée par Benjamin Biolay), mais cette seconde partie pêche par lieux communs (entendez par là une illustration d’une descente aux enfers, avec boîtes de nuits et héroïne).
Mais soutenons la volonté de casser un système à bout de souffle et qui n’arrive plus à représenter le monde : comme le dit Maria en interview, tout « ce cinéma fait par des hommes et pour des hommes » est remis en question de plus en plus avec l’arrivée de réalisatrices prometteuses (Rose Glass, Emerald Fennell, Julia Ducournau, Léa Mysius et tant d’autres) et qui souvent ont des choses plus intéressantes à dire que le Francis du coin.
Germain BrévotEnvoyer un message au rédacteur