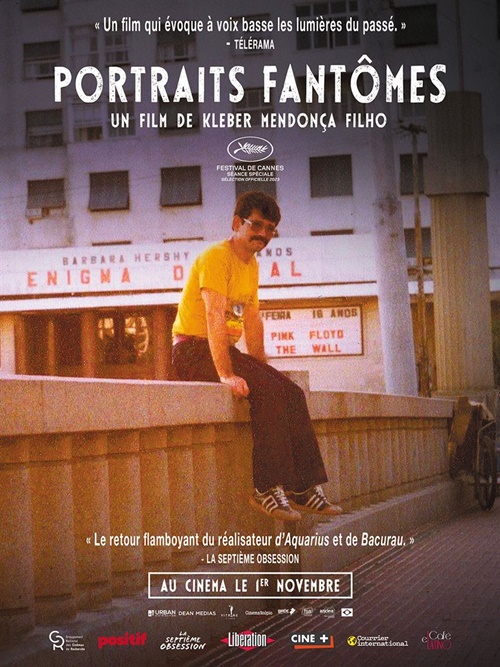LES BRUITS DE RECIFE
Synecdoche, Brazil

Il y a une série de plans furtifs qui ouvrent "Les bruits de Recife" : on y découvre un court diaporama d’images en noir et blanc autour d’une exploitation coloniale de cannes à sucre, avec ses dirigeants et ses travailleurs noirs. Des plans tout sauf anodins, mais d’entrée, on oublie vite leur existence, emporté que l’on est par la virtuosité narrative et visuelle d’un premier film en tous points époustouflant. Il ne faut pourtant pas se limiter à cela. La mémoire est de rigueur concernant ces fameux plans, tant ils aident à éclairer le dénouement final du récit en même temps que la faculté de Kleber Mendonça Filho à saisir l’état du Brésil d’aujourd’hui, surtout au travers d’une scénographie circonscrite à l’échelle d’un quartier de la ville de Recife. Une synecdoque virtuose, où le général est capté à travers le particulier, où la chronique sociale du quotidien est le vecteur d’une réalité historique bien plus large, où le calme ne fait que refléter l’explosion sans cesse retardée d’une société.
Avant que son final ne vienne illuminer le tableau éclaté du récit, "Les bruits de Recife" peut se décrire sans peine comme un « film choral », structuré en trois chapitres. Sauf qu’à la lourdeur narrative du genre, privilégiant en général l’enfilade de coïncidences dans l’entrecroisement des différentes histoires qui le composent, Mendonça Filho oppose une maîtrise sidérante de la topographie. Une sorte de toile d’araignée de destins, avec un seul et même immeuble comme épicentre, avec une communication à double niveau – horizontale à l’extérieur, verticale à l’intérieur. Le dispositif scénique est d’une impressionnante rigueur : format Scope d’une beauté saisissante, travellings millimétrés, jeu virtuose sur les échelles de plan, cadrages fixes surchargés de tension, sans oublier un grand nombre d’audaces formelles (image mémorable d’une « cascade de sang ») et surtout un remarquable travail sur le son. Dans son dossier de presse, le jeune cinéaste brésilien aimait décrire son film comme « un soap opéra filmé par John Carpenter ». Au vu d’un travail formel visant à installer une sensation imperceptible de danger au sein d’une micro-communauté, le parallèle n’est ni prétentieux ni hyperbolique.
Parce que, oui, durant un peu moins de deux heures, le film ne semble montrer rien d’autre que du banal. À peine une poignée de micro-histoires qui s’entrecroisent en sérénité : un patriarche qui joue les intraitables dans le quartier, son fils agent immobilier qui vit une histoire d’amour, une jeune mère qui se laisse aller à toutes sortes de plaisirs solitaires (le meilleur : se frotter le pubis contre une machine à laver en marche !), une petite frappe qui commet plusieurs vols, deux étranges vigiles engagés pour surveiller les alentours, etc… La vie semble alors s’écouler, sans grande surprise, avec ses aléas inévitables où la tension mesurée et réciproque succède toujours à la tranquillité sociale. Mais si l’on tend l’oreille et que l’on fait surchauffer les orbites, on saisit bien que c’est en réalité tout l’inverse. On sent ici une ambiance de paranoïa, une violence sur le point de se déchaîner, une sorte de territoire fantomatique où la vie semble se terrer derrière des immeubles résidentiels ultramodernes.
Ce que l’on voit (beaucoup de portes, de grilles, de caméras et de murs qui s’emboîtent) et ce que l’on entend (beaucoup de bruits qui deviennent suspects, qu’il s’agisse d’un aboiement répété ou d’une simple sonnerie) semble insuffler le malaise au travers d’actes plus ou moins anodins. Tension maximale, jamais relâchée, toujours au niveau le plus élevé. Il faudra donc, comme on l’évoquait plus haut, attendre la fin pour prendre le pouls de ce dispositif (on gardera le silence là-dessus), mais on restera en fin de compte bouche bée devant une telle force d’incarnation, devant une telle maîtrise du hors-champ et des non-dits, devant une telle enfilade de séquences virtuoses qui tendent à l’abstraction pour mieux toucher du doigt l’universel. Et ce qui en ressort est la cartographie d’un Brésil loin des images traditionnelles de violence et de pauvreté (on n’est pas dans "La Cité de Dieu", ici…), mais proche d’une société faussement moderne, prise au piège d’un passé impossible à oublier, qui tente l’évolution mais ne fait qu’attendre son implosion.
Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur